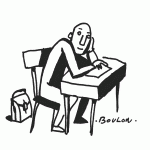 L’émancipation subordonne l’acquisition des savoirs aux choix des citoyens à partir de leurs expériences et besoins, tandis que l’instruction vise à donner au peuple ce qu’il doit savoir pour des raisons d’utilité et de stabilité sociales.
L’émancipation subordonne l’acquisition des savoirs aux choix des citoyens à partir de leurs expériences et besoins, tandis que l’instruction vise à donner au peuple ce qu’il doit savoir pour des raisons d’utilité et de stabilité sociales.
La question de l’émancipation par l’éducation et la culture se pose depuis longtemps et dès les Lumières ou la révolution française, elle fait l’objet de débats politiques. Ainsi, Condorcet à l’Assemblée nationale française les 20 et 21 avril 1792 : « L’instruction… doit assurer aux hommes de tous les âges de la vie la faculté de conserver des connaissances et d’en acquérir des nouvelles… ».
Un autre pédagogue soucieux d’émancipation est le français Joseph Jacotot (1770-1840), qui en 1818 s’est retrouvé à l’université de Leuven à devoir enseigner la littérature française à des étudiants qui ne connaissaient pas le français, lui-même ignorant tout du néerlandais. A partir d’une une édition bilingue du Télémaque de Fénelon, il leur a demandé d’apprendre par cœur le texte français. A son étonnement, il a découvert qu’après quelques temps, les étudiants étaient non seulement capables de répéter mais aussi de s’exprimer dans un français correct à propos de ce qu’ils avaient lu.
Quelles conclusions Jacotot va-t-il en tirer ? Contrairement au modèle dominant qui dit que l’élève apprend ce que le maître enseigne et qu’il s’agit de remplacer le vide de l’ignorance du premier par le savoir du second, il va affirmer que tout un chacun est capable d’apprendre et de comprendre par soi-même sans explication et qu’on peut même enseigner ce que l’on ne connaît pas. Il atteste ainsi l’autonomie irréductible du travail de l’intelligence, et le principe d’égalité des intelligences : le processus d’apprentissage va de savoir à savoir (et non d’ignorance à savoir). Là où on postule l’ignorance, il y a toujours un savoir et c’est la même intelligence qui est à l’œuvre dans tous les apprentissages intellectuels. Les différences de résultats d’apprentissages ne seraient pas dues à des différences de capacité intellectuelle mais à des différences de motivation et de confiance en soi. Le maître est là pour stimuler et accompagner la construction de son savoir : pour émanciper un élève, il faut le pousser à user de sa propre intelligence.
Il n’est pas possible dans le présent cadre de décrire en détail et d’approfondir la théorie et les implications pédagogiques remarquablement analysées par J. Rancière, dans le livre qu’il a écrit en référence à Joseph Jacotot, Le maître ignorant. Retenons ici que pour son auteur, un enseignement émancipateur est celui où l’intelligence des élèves n’est pas subordonnée à la mise en forme par une autre intelligence mais où elle découvre elle-même son propre cheminement et son propre pouvoir : il faut donc l’expérimenter pour acquérir la confiance nécessaire. En outre, Jacotot distingue déjà l’émancipation de l’instruction : la première subordonne l’acquisition des savoirs aux choix des citoyens à partir de leurs expériences et besoins alors que la seconde vise à donner au peuple ce qu’il devait savoir pour des raisons d’utilité et de stabilité sociales avec l’intention généreuses de la bonne intégration de tous.
Déjà, il place l’égalité non pas comme le but à atteindre mais comme le point de départ du processus d’émancipation.
C’est également dans ces années (autour de 1818) que l’on débat de deux modèles pédagogiques d’éducation de masses. A cette époque, les instituteurs sont confrontés à des classes de 60 à 80 et quelquefois plus d’élèves. Pour faire face, Jean-Baptiste de la Salle (1651-1719) avait édicté dès 1684 (publié en 1704) des règles pour une méthode simultanée : division par niveau (les faibles et les forts), place fixe et individuelle, discipline stricte, moniteurs choisis parmi ceux qui sont considérés comme les meilleurs et les plus normatifs, travail répétitif et simultané surveillé par un maître inflexible. Les objectifs sont clairement l’utilité sociale, la docilité, le respect de l’autorité, la sélection des meilleurs -et donc l’hypothèse de l’inégalité– et la compétition.
L’autre modèle est qualifié de méthode mutuelle et s’inspire de l’école mutuelle qui est le nom donné à une méthode d’enseignement apparue en Grande-Bretagne vers 1795 et qui a été diffusée en Europe, en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne et en France aux alentours de 1815. Dans ce modèle, tous sont tour à tour élèves et enseignants car tous ont des savoirs à transmettre, tout le monde apprenant à son niveau d’évolution et enseignant pour des niveaux acquis : rien de tel pour avoir confiance en soi et envers les autres car cette compétence n’est déniée à personne. Le maître est avant tout garant de la discipline générale. Par ailleurs, le mode égalitaire prend le pas sur le mode hiérarchique, les différences de niveaux sont motrices et l’échec est un défi pour tous : coopération et solidarité sont des nécessités et vont de pair avec l’apprentissage. L’évaluation ne s’élabore pas par rapport à un profil de compétence abstrait mais permet de construire un savoir singulier sur le cheminement de chacun et sur le pouvoir des intelligences. Ce projet est également influencé par la pratique inaugurée par J. H Pestalozzi (1746-1827) pour qui l’hétérogénéité des intelligences, des âges, des savoirs et la mixité sont des richesses. Il recommande, en outre, comme particulièrement déterminant, le fait pour les élèves d’exercer des activités et un travail hors école.
Après une quinzaine d’années d’application, c’est le modèle lassalien qui sera retenu alors qu’il demande six années pour acquérir les savoirs jugés nécessaires quand le modèle mutuel exige seulement trois années. Les arguments pour cette décision dans les textes officiels sont explicites. Ainsi : « Comment emploieront-ils leur temps jusqu’à 13 ans ? Que feront-ils de leur liberté ? Et les habitudes d’ordre, de docilité ? ». L’hypothèse de l’émancipation était sans doute trop risquée pour l’ordre établi et François Guizot, ministre de l’instruction publique sous Louis Philippe, confirmera en 1833 le choix du modèle lassalien. Signalons que l’enseignement mutuel a d’ailleurs été condamné par le pape Léon XII en 1824.
Outre le fait qu’ils balisent quelque peu la notion d’émancipation, ces deux exemples ont le mérite de montrer l’ancienneté -et donc la permanence- du débat et de rappeler si besoin en est le lien étroit entre les enjeux pédagogiques et les enjeux politiques.
Démocratie culturelle et d’éducation permanente
Au cours des années soixante et au début des années septante, quasi simultanément, plusieurs concepts prennent progressivement le devant de la scène et auront une influence considérable dans les débats sur la culture, l’éducation des adultes et la pédagogie en général. Il s’agit notamment des notions de démocratie culturelle, d’éducation permanente (qui, dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, tend alors à se substituer à celui d’éducation populaire).
Bien que distinctes, ces deux notions sont assez voisines : elles se réfèrent à des filiations politiques proches, s’appuient notamment sur les mêmes analyses sociologiques et explorent diverses pistes pédagogiques communes. En outre, elles structureront de manière transversale des pans entiers de la politique culturelle et les textes réglementaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Dans le cas de la démocratie culturelle, le concept s’est, entre autres, forgé en réaction aux politiques qui visaient une démocratisation de la culture et qui étaient contestées au nom même des valeurs dont elles se réclament : à la fois l’universalisme, la liberté d’accès à la culture et l’égalité. Pseudo-universalisme quand il s’agit de proposer les œuvres appréciées par la classe dominante et égalité trompeuse puisque ces politiques affirment une supériorité culturelle au mépris des subcultures spécifiques de certaines classes ou groupes sociaux. On découvrait d’ailleurs qu’elles avaient d’abord pour effet de reproduire sinon de renforcer les inégalités culturelles.
Les mécanismes de reproduction des inégalités culturelles ayant été mis à jour par la sociologie, il était devenu clair que la culture n’était pas une affaire d’excellence individuelle. Les politiques de démocratisation de la culture constituent néanmoins toujours le paradigme dominant de la politique culturelle même s’il est régulièrement contesté (en ce compris par nombre d’artistes contemporains). Elles visent à une réduction des inégalités par l’accès de tous aux mêmes œuvres. Elles veulent, notamment au moyen d’une pédagogie adaptée, mettre des œuvres susceptibles de servir l’éveil culturel de tous à la disposition du plus grand nombre possible par divers moyens de diffusion. Dans cette ligne, tous sont récepteurs de culture.
Au plan des conséquences politiques et pédagogiques, on soulignera notamment qu’on suppose un rapport d’extériorité et de supériorité entre culture cultivée, d’une part, et populations jugées incultes ou insuffisamment acculturées, d’autre part. On donne comme mission à la culture d’assurer un minimum de partage des savoirs et des valeurs nécessaires à des communautés afin d’organiser la cohésion de la société moderne qui impose que les inégalités soient un peu réduites. Ces politiques supposent une certaine unanimité du corps social pour un accès à un ensemble d’œuvres unanimement appréciées, pariant sur l’existence d’une universalité esthétique et de la transcendance des œuvres au-delà des conditions socio-historiques de la création artistique.
La tension qui relie démocratisation de la culture et démocratie culturelle peut être schématiquement caractérisée par l’opposition entre les tenants de la culture pour tous et ceux des cultures de et par tous. Pour les tenants de la démocratie culturelle, il existe des réalités culturelles relativement autonomes en fonction des contextes d’émergence et d’organisation de groupes sociaux et de collectivités : on parlera de subcultures ou de sociocultures liées à certains groupes sociaux, de cultures de quartiers, de cultures populaires, de cultures régionales, de cultures d’organisation, de cultures jeunes, comme étant des réalités isolables, porteuses de signification et de valeurs, avec une dynamique propre, et ayant une pertinence pour l’action culturelle.
Dans ce cadre, il n’y a pas a priori de culture supérieure mais des cultures différentes et toutes sont qualitativement intéressantes car elles sont à l’œuvre dans tous les aspects de la vie collective : on parlera donc de pluralité, de diversité et de « déhiérarchisation » relativiste des cultures.
A l’idée d’universalité de l’esthétique on oppose celle de la capacité individuelle et collective de créativité et d’invention. La démocratie culturelle se différencie donc de la démocratisation de la culture en ce qu’elle n’est pas un processus de comblement d’un manque de culture par une culture cultivée, mais bien de soutien à la production d’une culture par les individus et les groupes sociaux. Pour elle, l’idée que l’on va « élever le peuple » par un apport de culture extérieure implique un positionnement qui induit l’inégalité et le processus de sa reproduction.
En pratique, il s’agit notamment de soutenir et de renforcer l’expression et l’identité des personnes, groupes sociaux et communautés d’appartenance, comme condition et étape de l’ouverture à d’autres cultures. Il s’agit moins d’égalité des chances de consommer de la culture ou d’accéder aux œuvres que d’égalisation de chance de chacun de participer à la création et au développement des cultures en mouvement. Tous sont émetteurs et récepteurs de culture.
Ici aussi, l’idée d’émancipation s’oppose à celle d’intégration. La première implique de partir de l’idée de la capacité de n’importe qui d’être producteur de culture ou tout au moins de participer à la culture en mouvement. Tous sont producteurs de culture.
Il importe peu de se préoccuper de ce qu’ils produisent, l’essentiel est la prise de conscience de cette capacité. L’important n’est pas d’établir un programme d’éducation culturelle mais de mettre les individus en possession de leur propre culture évolutive. Ce qui compte, c’est le rapport d’une culture à une autre et non la capacité de chacun de s’acculturer au modèle dominant. Tous producteurs, émetteurs et récepteurs, car les uns ne pouvant aller sans les autres.
Éducation permanente, un contexte d’émergence et des filiations diverses
1968 et les années qui suivent peuvent être caractérisées brièvement comme une période de critique et d’expérimentation sociales : remise en cause des modèles politiques (socialisme autogestionnaire, participation, retour en force de l’anarcho-syndicalisme…) et des modèles pédagogiques (notamment autoritaires : remise en cause de l’autorité de celui qui sait, de la science…) avec en toile de fond l’émergence de ce que l’on a appelé les nouveaux mouvements sociaux (féminisme, anti-consumérisme, environnementalisme …). La culture devient un enjeu central : elle apparaît comme l’instrument de domination et de reproduction de l’idéologie dominante, comme la cause de l’immobilisme social.
En conséquence, pour nombre d’acteurs, l’éducation permanente est donc pensée comme le développement d’une compétence en critique sociale et d’une capacité d’action collective transformatrice des conditions qui déterminent les situations réelles de la vie, les rapports sociaux et le changement social. Dans cette même ligne, l’accent est mis sur une approche critique de la culture et des institutions culturelles. Cependant l’éducation permanente restera relativement longtemps une notion polysémique, floue, et changeante.
C’est dans les années qui suivront que se distingueront progressivement les notions comme l’éducation tout au long de la vie (long live éducation ou la permanence de l’éducation – à ne pas confondre – qui veut rencontrer les nécessités d’adaptation à une société en constante évolution), la formation permanente (ici c’est l’évolution des procès et du marché du travail qui est la référence) ou l’éducation non formelle (réalisée en dehors de l’institution scolaire qui place le bénéficiaire comme acteur central du processus éducatif et le considère comme producteur de savoir et de culture au départ de son expérience de vie) ou encore la promotion socioculturelle des travailleurs (par rapport à la formation dite de promotion sociale). Il importe ici de différencier ces notions qui recoupent en partie celle d’éducation permanente. Pour clarifier, il est utile de préciser que les deux notions les plus proches de l’éducation permanente qui les intègre toutes deux sont d’une part l’éducation non formelle définie ci-dessus et, d’autre part, l’éducation populaire. Cette dernière, dont l’histoire est traversée par plusieurs courants, peut être caractérisée de manière schématique par deux orientations dominantes.
L’une est paternaliste et part du postulat de l’incompétence populaire : il y a manque d’éducation et de culture, c’est un vide à combler. L’autre est celle qui correspond le plus à la notion d’éducation permanente. On postule alors l’égalité et l’existence de compétences diverses : le terme signifie alors l’éducation de chacun par chacun (mutuelle) et populaire veut dire que l’éducation est l’affaire de tous. Il y a des potentialités à développer. On voit bien ici la proximité de la seconde avec la démocratie culturelle et l’éducation permanente. On peut la définir comme un ensemble d’actions visant à ce que tout un chacun –individus, groupes ou collectifs– puisse transformer l’expérience qu’il a de sa situation en expression, puis en savoir, pour construire ou se positionner dans un rapport de force permettant d’agir sur l’environnement. C’est un travail culturel en interaction étroite avec la transformation politique, sociale et économique.
Parmi les filiations explicites des porteurs du projet d’éducation permanente, il faut notamment souligner la référence aux expériences d’actions collectives et aux pratiques collectives d’autoformation réalisées dans la résistance pendant la guerre de 1940-1945. De même, il ne faut pas négliger l’influence de l’école de Francfort pour qui les industries culturelles et la consommation de masse traversent tous les champs et tous les moments de la vie : de là découle la nécessité de la permanence d’une distance critique et d’un développement de formes permanentes d’éducation. C’est une rupture avec l’identification du temps de la culture à ceux de l’école et du loisir.
En ce qui concerne les implications pédagogiques, on retiendra surtout que la notion d’éducation permanente constitue une transversale intégrant tous les champs et tous les moments de la vie et qu’elle considère les individus et les groupes ou collectifs comme :
- Des acteurs sociaux, (au sens large y compris les champs politiques, économiques et culturels), à la fois déterminés (objets d’influences sociales) et se déterminant (agents de transformations sociales).
- Des producteurs de savoirs et de culture à partir de l’analyse de leurs expériences de vie, des pouvoirs subis et agis.
- Les acteurs principaux du processus d’éducation centrés sur une (re)prise de pouvoir sur leur vie.
- La définition de la citoyenneté qui correspond peut-être le mieux est la suivante : et révolte, et coopération.
Auto-analyse et réflexivité: analyse culturelle et pédagogie institutionnelle
Une des conditions de toute émancipation et expérimentation sociales réside dans le développement de capacités d’analyse culturelle et d’autoanalyse car être un acteur social – c’est-à-dire produire et non reproduire – suppose cette capacité. L’autoanalyse, c’est se regarder agir, se regarder instituer, gérer l’organisation et le pouvoir plus ou moins démocratiquement… Quelle pratique démocratique mettre en place pour l’émancipation ?
C’est également faire place au désir (et non aux désirs), cet appétit d’être qui est à rendre visible et conscient sans pour cela s’y assujettir. Cela implique l’appropriation progressive d’un outillage conceptuel qui se construit notamment à partir de l’analyse culturelle et de la pédagogie institutionnelle.
Dans l’analyse culturelle, il s’agit de s’entraîner à repérer les institutions culturelles et comment la société structure à leur insu les manières de penser et d’agir des individus, agit sur leur personnalité, leur culture et leur système de valeurs, prévoit et modifie des opinions, des attitudes, des comportements, vise leur assujettissement identitaire.
Lorsque ce travail est opéré avec le groupe en formation sur son propre fonctionnement et sa propre dynamique institutionnelle, on parle d’auto-analyse et de pédagogie institutionnelle.
Précaution sémantique : il y a émancipation et émancipation, autonomie et auto-socionomie. Dans le mot émancipation, il y a l’idée d’une action qui vise « à dégager d’une sujétion, d’une autorité, d’une domination, qui cherche à affranchir, à libérer d’un état de dépendance ».
Dans le contexte de l’époque – plus encore que maintenant – on ne se limite pas à une conception individuelle et l’émancipation implique aussi une dimension collective : car agir dans la transformation sociale implique qu’opérer, c’est coopérer. Il ne faut donc pas réduire l’idée d’émancipation en la faisant correspondre peu ou prou à celle d’autonomie individuelle ; ou encore à celle d’un passage de la dépendance à l’indépendance plutôt qu’à celle d’interdépendance. A cette époque la notion de collectif, de microcollectifs ou de groupes-sujets (Guattari) est très prégnante alors qu’actuellement la société contemporaine exacerbe la nécessité d’être des individus autonomes et de se conformer à l’idéologie de se réaliser soi-même, de cultiver une identité personnelle. La position théorique de référence est que le processus de subjectivation (d’advenir comme sujet) ne peut se penser en dehors de la double dimension psychologique et sociale, les déterminismes sociaux étant aussi constitutifs de l’autonomie. Certains utilisent d’ailleurs l’expression auto-socionomie pour représenter la tension dialectique qui réunit les deux pôles constitutifs du sujet.
La question du pouvoir, de son appropriation et de sa gestion individuelle et collective – autrement dit, la question du politique – est au cœur de l’idée d’émancipation. Une pédagogie à visée émancipatrice est éminemment politique : elle se doit d’être à la fois d’apprentissage démocratique (accent mis sur le contenu) mais aussi de démocratie de l’apprentissage (accent sur les pratiques en formation). Plus que le contenu du discours sur la démocratie, c’est l’institution et la forme pédagogique qu’elle se donne qui sont le message démocratique. Inculquer un dogme, fût-il celui de la démocratie, ou une croyance en elle forme des dogmatiques et des croyants, non des acteurs ou des praticiens.
Comment émanciper par un apprentissage pratique et théorique de la démocratie ? Comment développer une praxis pédagogique à visée démocratique ? Comment une pédagogie peut-elle constituer à la fois un moyen pour plus de démocratie et une expérience démocratique en elle-même ? Comment faire d’un groupe en formation une microsociété démocratique et ne pas reproduire le modèle social dominant critiqué ? Comment produire et non reproduire ? Comment faire de la formation une situation de vie réelle qui fait d’un groupe une société, un espace d’évolution et de questionnement des institutions culturelles. Car émanciper, c’est aussi prendre une distance critique avec les assujettissements identitaires qu’une culture dominante voudrait imposer.
Émancipation pédagogique et démocratie d’apprentissage: une dimension d’autoformation collective
L’idée d’autoformation est à différencier de celle d’autodidaxie : dans le premier cas, l’accent est mis sur la construction singulière d’un savoir opérant et d’une compétence d’action, dans le second, sur une appropriation de savoirs extérieurs.
En pratique, ce principe pédagogique se traduit dans l’alternance de moments d’autoformation et d’hétéroformation comme dans la tradition du mouvement ouvrier. La dimension émancipatrice de cette approche réside dans le postulat que, individuellement et collectivement, tous ont des savoirs et des compétences et que tous peuvent être producteurs de savoirs et de compétences, notamment pédagogiques et méthodologiques, les savoirs extérieurs étant considérés comme des ressources documentaires.
L’idée d’émancipation pédagogique postule donc que tout le monde peut être pédagogue car tout le monde a un savoir sur ce qui a été formateur dans sa vie. Et donc sur comment se former et comment former. Dans cette logique, le travail vise à renforcer chez chacun la capacité de repérer les moments formateurs, leurs caractéristiques et sa propre capacité d’autoformation. Simultanément, on développe celle de former les pairs ce qui implique de former pédagogiquement tous les « s’éduquant » et de développer chez eux un regard critique sur les méthodes pédagogiques. Il s’agit d’identifier, et de les développer par un éclairage progressif les hypothèses pédagogiques implicites et d’entraîner les formés à en construire, les mettre en œuvre et les évaluer notamment dans les travaux de groupes. Cela mène au développement progressif de la responsabilité collective du travail pédagogique et le retour de la tradition de l’enseignement mutuel. Dans ce type de pédagogie, les objectifs de la formation sont négociés.
Au début ils sont proposés, ensuite progressivement réajustés puis renégociés avec les « se formant » au fur et à mesure des évaluations et de l’émancipation pédagogique. La définition des objectifs permet une évaluation du chemin parcouru et non de contrôler un hypothétique niveau de connaissances ou de compétences d’un individu abstrait. Notons qu’il ne s’agit pas seulement d’objectifs individuels – encore que ceux-ci soient respectables et doivent évidemment aussi trouver toute leur place -, mais bien aussi d’objectifs communs des groupes en formation et de leurs projets de vie. Le pouvoir pédagogique est progressivement subordonné à la fois à leurs enjeux et aux exigences extérieures et la gestion de la formation est intégrée dans le processus de formation.
Les différents acteurs sont parties prenantes de l’évaluation de la formation et de ses retombées. Cela va jusqu’au choix des objectifs, méthodes dans le cadre d’un budget et d’un horaire à négocier avec les autorités académiques et ministérielles.
La formation devient donc un espace de négociation politique en fonction des projets des participants. L’analyse des demandes individuelles et collectives est primordiale car la formation se veut en prise directe sur la vie quotidienne : elle constitue une microsociété démocratique sous forme d’une communauté coopérative.
La thèse centrale est qu’émancipation intellectuelle et expérience politique émancipatrice sont indissociables et que c’est cette simultanéité qui serait déterminante : une expérience d’auto-construction collective de pouvoir politique et pédagogique associée à la production d’un savoir singulier et d’une capacité d’action transformatrice.
En langage actuel, on pourrait dire de manière synthétique que l’auto-socio-construction de pouvoirs est inséparable de l’auto-socio-construction de savoirs et que, sans nier le renforcement réciproque, la première semble souvent précéder et être condition de la seconde.
Un article de Jean-Pierre Nossent, publié dans la revue Antipodes d‘ Iteco, n°199, décembre 2012
Pour consulter le tableau récapitulatif de cet article, allez voir « L’émancipation, entre l’éducation permanente et l’aide sociale »


